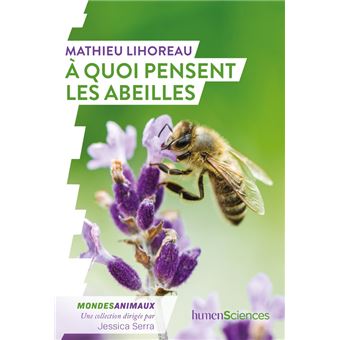
À quoi pensent les abeilles ?
Alain Lenoir Mis à jour 02-Avr-2025
À quoi pensent les abeilles ? de Mathieu Lihoreau, éd Humensciences (2022)
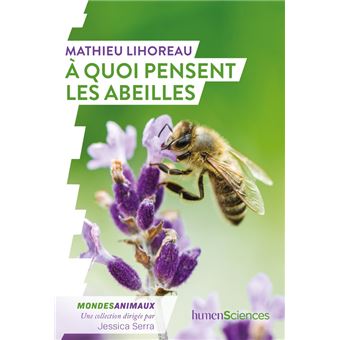
On parle beaucoup
en ce moment des sentiments, des émotions, de la pensée, de l'intelligence,
de l'empathie chez les animaux. Deux livres récents y sont consacrés
qui parlent un peu des fourmis et des abeilles.
- À
quoi pensent les animaux ? de Claude Baudoin
- Comment pensent les
animaux, de Loïc Bollache
Le livre de Mathieu arrive donc au bon moment. L'écriture est agréable, c'est facile à lire et à comprendre pour les non spécialistes. Il raconte aussi un peu sa vie, par exemple qu'il a des problèmes d'oriention et de mémoire contrairement aux abeilles, et on devine qu'il aime les films de science-fiction. Il parle des endroits et laboratoires où il a eu la chance de travailler avant de venir au CNRS à Toulouse. Ce n'est pas un livre sur la biologie de l'abeille, ni sur l'apiculture, mais tous les aspects sur les phénomènes qui dépendent du cerveau et où l'abeille nous surprend tous les jours de plus en plus. Les bourdons lui plaisent aussi beaucoup et sont très présents dans le livre. Il parle aussi des guêpes et des blattes. Tous les termes utilisés en ce moment sont présents, je signale une seule page, mais c'est présent souvent : charge mentale, conscience (p.119, 121), émotions (p.109), personnalité, bonne humeur des bourdons (p.106).
Voici quelques
passages choisis selon mes propres centres d'intérêts donc c'est
très subjectif..
- La bulle de savon de l'abeille (p.15) "j'imagine que les abeilles
sont incapables de distinguer une symphonie de Mozart d'un tube de Jo Dassin.
Car seule notre bulle nous le permet, mais alors, à quoi ressemble la
bulle d'une abeille ?".
- Les prouesses d'orientation
(p.20->) avec des repères visuels comme chez les bourdons et que l'auteur
lui-même a vécu. Les bourdons utilisent aussi les champs électriques
(p.25).
- L'apprentissage
par observation existe chez les bourdons (p.74)
- Le problème du voyageur de commerce chez Chittka à Londres sur
les bourdons (p.40).
- La reconnaissance
individuelle chez les guêpes (p.71->).
- Les effets délétères de la nicotine (p.156), des néonicotinoïdes,
des métaux lourds (plomb, arsenic, mercure et cadmium, p.163), des drogues
comme la procaïne par Jean-Marc Devaud (p.100).
- Le rôle des hydrocarbures des fleurs et les marques chimiques laissées
par les abeilles quand elles se posent sur une fleur (p.96).
- L'apprentissage par observation
(p.74).
- Le camouflage
chimique des judas dans le film de science fiction "Mimic" de
1997 (p.52) : "Le petit groupe d'humains qui tente de sauver New york
a la bonne idée de se recouvrir le corps des sécrétions
collectées sur les cadavres de judas." (insectes génétiquement
modifiés).
- L'odeur
coloniale est constituée d'hydrocarbures comme on le sait depuis
lontemps chez les fourmis, mais chez les abeilles "l'odeur des matériaux
du nid est un élément clé de l'identité chimique
des abeilles" (p.60). Les odeurs des ruches voisines sont proches
et les abeilles peuvent changer de ruche et "mon formateur en apiculture
vaporise du pastis dilué
dans ses ruches pour masquer leurs odeurs coloniales." (p.61).
- Bien sûr tout sur les blattes (p.63->)
- Les travaux de Turner
qui sortent de l'ombre (p.92).
- Le cerveau
de l'abeille qui "contient un million de neurones et un milliard de
synapses" avec un neurone de la récompense qui s'active avec
le sucre. Il y a les corps pédonculés dont l'ancien nom était
"corps champignonneux" : "deux cèpes de Bordeaux plantés
au milieu de leur cerveau" (p.88).
- La mémoire phénoménale
des abeilles étudiée entre autres par Menzel (p.99) et plus récemment
pour détecter les patients atteints du Covid-19, même si cela
a été critiqué par Martin Giurfa, ce que l'auteur ne dit
pas (p.100).
- Un chapitre "Les bourdons
ne sont pas toujours de bonne humeur" (p.106). Ils présentent
des émotions positives et négatives (Lars Chittka). L'auteur parle
des effets de l'isolement
chez les blattes : "Et si les blattes étaient, elles aussi,
sujettes à la dépression ?" (p.107).
- La conscience des insectes
"Si l'on applique les mêmes critères comportementaux et
cognitifs aux insectes qu'aux vertébrés, alors ceux-ci peuvent
être considérés comme conscients, avec pas moins de certitude
que des chiens ou des chats" (p.121).
- Automates et décisions
collectives. Michel Krieger et Laurent
Keller ont créé une colonie de robots non programmés
pour la collecte collective d'aliments. Ils ont observé que ces robots
développent un système d'approvisionnement collectif (p.142).
Jean-Louis Deneubourg qui "n'est pas (totalement) fou)" a
fait une expérience comparable avec la peur de la lumière chez
les blattes et Mathieu a repris ces expériences à Rennes (p.143).
- Les frelons (p.185).
Sur les fourmis
- Le podomètre
des Cataglyphis du désert selon Rüdiger Wehner (p.34)
- La super-colonie de fourmis rousses sur l'île d'Hokkaido au Japon ("Ezo-akayama-ari")
(p.62).
- La super-colonie de fourmis
d'Argentine (p.63)
et les méfaits de cette fourmi sur des colonies de bourdons dans le laboratoire
de Toulouse (p.126). "Toutes ces populations invasives ont perdu leur
capacité de reconnaisance coloniale. C'est peut-être d'ailleurs
la clef de ces invasions à succès."
- La sagesse de l'essaim : "l'intelligence
collective peut être supérieure à la somme des intelligences
individuelles". Jean-Louis Deneubourg et ses collaborateurs "ont
réalisé de nombreuses expériences pour décrire comment
cette sagesse collective pouvait émerger de comportements individuels
très simples dans les colonies de fourmis." (p.132
- Temnothorax et la prise de décisions collectives (p.134).
- La distanciation sociale chez les fourmis par Sylvia Cremer et Laurent
Keller. Les fourmis réduisent leurs interactions sociales avec les
individus contaminés par un champignon
(p.170).
-
Interviews
- La
terre au Carré du 14 avril 2022. "Avez-vous déjà
observé une abeille ? De près, avec attention, sans la perturber
? Vous vous êtes alors peut-être demandé ce qu'il se passait
dans sa tête. A-t-elle eu peur ? Vous a-t-elle seulement remarqué
? Voici toutes les questions que pose notre invité Mathieu Lihoreau dans
son livre."
Extrait du prologue.
"Je les ai d’abord maltraités. Tout petit, j’habitais
une maison avec un jardin. Comme beaucoup d’enfants en bas âge,
j’avais pris l’habitude de goûter tout ce que je trouvais
par terre. Souvent, j’attrapais des fourmis. D’autres fois, je m’en
prenais aux coccinelles au grand désarroi de mes parents, qui prenaient
pourtant soin de bien me nourrir. Puis, en grandissant, j’ai commencé
à jouer à la guerre. J’assiégeai les fourmilières
avec mes soldats en plastique et je réclamai leur chef. J’étais
alors loin d’imaginer l’immense dévouement de ces insectes
qui protègent leurs reines à tout prix, n’hésitant
pas à piquer et à mordre tout intrus tentant de s’en approcher.
Plus tard, j’ai voulu les apprivoiser. Je mettais des fourmis dans un
pot à confiture vide dont j’avais percé le couvercle pour
m’assurer qu’elles respirent correctement. Puis j’ajoutais
des brindilles pour qu’elles ne meurent pas de faim et des gendarmes pour
leur tenir compagnie. Malheureusement pour ces derniers, les fourmis peuvent
se montrer très agressives et ont besoin de protéines animales
pour nourrir leurs larves et se reproduire…
Plus grand,
j’ai appris à les aimer. C’est sur les bancs de l’université
que j’ai découvert l’éthologie, la science du comportement
animal. Durant les séances de travaux pratiques, nous regardions des
vidéos d’animaux et devions noter tout ce que nous observions pour
essayer de comprendre leurs comportements. Combien de fois un jeune goéland
argenté devait-il quémander de la nourriture à sa mère
pour obtenir un poisson ? Au bout de combien de temps les oies bernaches décidaient-elles
d’arrêter de brouter de l’herbe et de lever la tête
pour surveiller la présence de prédateurs ? Ces vidéos
étaient interminables. Mais elles ont déclenché chez moi
une vocation.
J’ai découvert la recherche avec mon professeur d’éthologie, sans vraiment me soucier du travail qu’il me proposerait. Il me fallait un stage et une bonne note. Alain Lenoir avait passé sa carrière à étudier la communication chimique chez les fourmis. Avec lui, j’ai donc disséqué des centaines de fourmis et analysé leurs odeurs par des techniques de physique-chimie. Pas de comportement. Ni de chimpanzés. Mais après plusieurs semaines de travail, j’ai pu conclure que les fourmis françaises avaient une odeur différente des fourmis espagnoles, bien qu’elles fussent de la même espèce. Comme je n’avais pas lu la littérature scientifique en détail (ce qu’il faut toujours faire avant d’attaquer une question de recherche), j’ignorais que je n’avais rien découvert de très nouveau : chez la plupart des espèces de fourmis, les membres d’une même colonie ont la même odeur et celle-ci est en partie déterminée par les nombreux gènes qu’elles ont en commun. Par conséquent, des fourmis issues de colonies éloignées géographiquement (par exemple des deux côtés des Pyrénées) le sont également génétiquement et olfactivement [1]. Malgré cette porte ouverte enfoncée, Alain semblait satisfait de mon travail et m’encouragea à continuer dans cette direction. Ce que je fis avec enthousiasme et c’est comme cela que j’en suis venu à me passionner pour la personnalité des blattes, le vote des mouches, la navigation des bourdons, l’apprentissage des abeilles et bien d’autres aspects de la vie intime des insectes que je raconte dans les chapitres de ce livre.
Jusqu’à
très récemment, les insectes étaient considérés
comme dépourvus de toute forme d’intelligence, ou comme le proposait
le philosophe et scientifique français René Descartes (1596-1650)
de simples « machines réflexes». On sait désormais
que tous les animaux sont doués de certaines formes d’intelligences
et que celles-ci évoluent avec les espèces. Les insectes ne sont
pas une exception. Ils ont un répertoire cognitif extrêmement riche
et parfois déroutant à nos yeux. Cela est d’autant plus
remarquable que leur cerveau est ridiculement petit comparé au nôtre.
Cette sophistication mentale n’est pas le fruit de l’imagination
d’un chercheur isolé (moi), mais celui de milliers d’observations
scientifiques, rigoureuses et indépendantes rapportées par des
centaines de personnes depuis plus d’un siècle.
Dans ce livre, je décris les différentes formes d’intelligence
décrites chez les insectes et je discute leurs limites. Je vais vous
parler principalement d’espèces qui ont été observées
de très près depuis plusieurs siècles et que je connais
bien : les abeilles."
[1] En fait, il s'agissait de fourmis Aphaenogaster espagnoles : A. iberica et A. senilis.