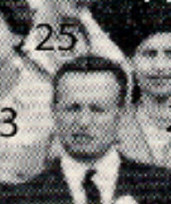
Gervet Jacques (1934-2018)
A Toulouse (1965) 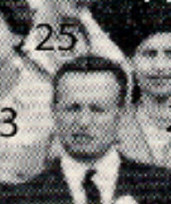
Alain Lenoir Mis à jour 10-Fév-2026
Selon un mail du 6 décembre 2018 de la SFECA "Nous venons d'apprendre le décès de notre collègue Jacques GERVET, qui fut directeur de l'équipe d'éthologie théorique à Marseille avant d'intégrer le Centre de Recherche sur la Cognition Animale à Toulouse en 1994. Il a été pendant longtemps un des piliers de la Société Française pour l'Etude du Comportement Animal. Après l'arrêt de ses activités au laboratoire, Jacques Gervet a poursuivi une intense activité intellectuelle en écrivant plusieurs ouvrages dont "Les parallèles se rencontrent à l'infini" (2016), "Lumières et ombres des humanismes athées contemporains" (2014), " Du réflexe au désir : pour une archéologie du sens" (2018) article à paraître dans la Revue de questions scientifiques de l'Université de Namur."
Selon Michel Pratte (mail
du 12 décembre 2018) "Jacques GERVET, Directeur de Recherche
au CNRS, nous a quittés le mercredi 5 décembre 2018. Jacques
a fait ses débuts de chercheur en 1954 au Laboratoire d’Évolution
des Etres organisés dirigé par P.P. Grassé, à Paris.
Arrivé à Marseille au début des années 1960 lors
de la création de l’Institut de Neurophysiologie et Psychophysiologie
dirigé par J. Paillard, Jacques Gervet intègre le département
de Comportement Animal. Il soutient en 1965 sa thèse d’État
ayant pour thème « La ponte et sa régulation dans la société
polygyne de Polistes gallicus ». Après avoir dirigé, de
1985 à 1994, l’équipe « Ontogenèse du comportement
et vie sociale » au sein du Groupe des Laboratoires de Marseille, Jacques
Gervet rejoint, jusqu’en fin de carrière, le Laboratoire d’Éthologie
et Psychologie Animale de Toulouse, qui deviendra le Centre de Recherches sur
la Cognition Animale (CRCA). Jacques a toujours pris très à cœur
les tâches d’ enseignement, de formation, et assuré aux étudiants
un encadrement à la fois méthodique et ouvert à la discussion
; il a toujours tenu à soutenir et aider ses étudiants en thèse,
à leur obtenir un débouché professionnel au CNRS ou à
l’Université. Jacques Gervet a développé tout au
long de sa carrière scientifique, avec ses étudiants et collaborateurs,
deux axes de recherche en utilisant comme modèles animaux la guêpe
sociale Poliste et la guêpe solitaire Ammophile :
- Le premier axe concernait l’étude de comportements instinctifs
complexes (construction du nid chez le Poliste ; épigenèse de
la séquence de paralysation de la proie et déroulement du cycle
de nidification chez l’Ammophile).
- Le deuxième axe de recherche s’intéressait aux interactions
entre individus au sein d’un groupe social, depuis l’effet de groupe
(sensu Grassé) jusqu’à l’auto-organisation des tâches
collectives dans la société de Polistes.
Jacques Gervet s’est également beaucoup intéressé
aux problèmes épistémologiques posés par l’étude
du comportement animal, comme l’application des notions de système
et de niveau d’intégration, ou le type de représentation
du monde que peut se faire un animal (co-édition de l'ouvrage "La
représentation animale" aux Presses Universitaires de Nancy, 1992).
Il a aussi réfléchi sur les étapes évolutives ayant
conduit à l’apparition des processus intentionnels chez les animaux.
Dans le domaine de l’évolution des systèmes vivants, il
a d’abord fait une critique sévère de la Sociobiologie et
des excès du darwinisme social (co-édition de l'ouvrage "Misère
de la sociobiologie", PUF, 1985). Puis il a souligné l'existence
des modes de transmission non génétiques des comportements (environnemental,
proto-culturel), ce qui permet de discuter d’un modèle darwinien
de l’hominisation qui n'implique aucune nécessité d'une
guerre entre individus ou entre lignées. Dans son dernier article scientifique,
à paraître dans la Revue de Questions Scientifiques (Université
de Namur), il recherche chez l’Humain ce qui marque l’ascendance
phylogénétique et ce qui spécifie la rupture par rapport
au Primate pré-humain, notamment au niveau linguistique.
Jacques Gervet avait conservé une activité intellectuelle intense
qui s’est traduite par la publication, ces dernières années,
de deux ouvrages traitant des relations difficiles entre le catholicisme et
les « humanismes athe´es contemporains » que sont le marxisme,
le freudisme et le rationalisme scientiste (Lumières et ombres des humanistes
athées contemporains, Ed. Baudelaire, 2014; Les parallèles se
rencontrent à l'infini. Ed Mélibée, 2016). Tout au long
de sa vie, il fut un humaniste engagé socialement (par son implication
dans le syndicalisme) et politiquement (par son soutien sans faille à
la Palestine). Il s’est essayé au théâtre, auteur
de « La Quête de Gilgamesh » (2006, ed. JY Normant) reprenant
des thèmes anciens pour questionner l’actualité : relations
entre hommes et femmes, rapports entre politique humaine et soumission divine,
recherche d’immortalité ... Nous perdons un ami, un collègue
dont les grandes qualités humaines et l’ouverture d’esprit
nous ont marqués."