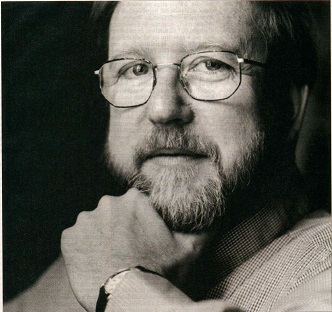
Pierre
Jaisson: ne tirez pas sur la sociobiologie 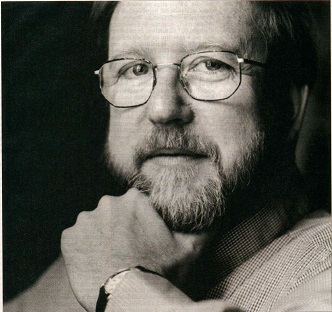
Alain Lenoir mis à jour 14-Mai-2021
Par Françoise Harrois-Monin et Charles Gilbert (publié le 01/07/1993). lexpress.fr, 1 juillet 1993. Lien Pdf
Jamais une science n'a fait l'objet d'autant de polémiques, d'anathèmes et de procès d'intention. Depuis son apparition, dans les années 70, la sociobiologie a été totalement marginalisée par les milieux universitaires français. Cette discipline qui s'intéresse aux bases biologiques des comportements sociaux - chez les animaux et chez l'homme - a fait scandale, car elle proposait, pour la première fois, d'expliquer certaines attitudes sociales, comme l'altruisme, par des mécanismes génétiques. Très vite, la nouvelle droite en a proposé une interprétation déterministe (les comportements sont dictés par les gènes), dans le dessein de justifier les inégalités sociales. Résultat: la sociobiologie a été violemment combattue par les intellectuels de gauche, qui l'ont accusée de nier le libre arbitre. «Un faux procès», répond Pierre Jaisson, professeur d'éthologie à l'université de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), qui s'insurge dans son livre «La Fourmi et le sociobiologiste» (éditions Odile Jacob) contre les a priori et les malentendus. La sociobiologie est pour lui une science dont on a dévoyé l'objet et les théories, sans jamais reconnaître l'importance de ses découvertes dans la compréhension du fonctionnement des sociétés. Une discipline mal aimée qu'il est temps de réhabiliter.
L'EXPRESS:
Vous venez d'entreprendre la réhabilitation d'une science considérée
comme taboue en France depuis quinze ans. Pourquoi?
PIERRE JAISSON: L'absence
de la sociobiologie du paysage scientifique français a entraîné
un vrai déficit culturel. Nous restons aujourd'hui l'un des rares pays
où l'on forme des générations de biologistes dans l'ignorance
des résultats apportés par cette discipline. Alors qu'on ne cesse
d'en parler dans les congrès internationaux, nos chercheurs constatent
qu'ils manquent totalement d'informations. Dans mon livre, j'ai voulu dresser
un bilan impartial de l'état de ces connaissances, afin que les gens
de bonne foi puissent se faire eux-mêmes une opinion, au lieu de s'en
tenir aux idées reçues qui se sont imposées.
- Quelles idées reçues?
- La sociobiologie n'est pas une idéologie. Ce n'est pas non plus une
théorie. C'est une science. Son point de départ: la constatation
que l'apparition de la vie sociale est l'un des événements les
plus importants de l'évolution. Son objectif: essayer d'identifier les
conditions biologiques qui ont favorisé cette explosion du fait social
dans la nature. Les sociétés d'insectes constituent ainsi le domaine
de prédilection des sociobiologistes, celui où ils ont engrangé
le plus de connaissances nouvelles. Mais ils s'intéressent aussi aux
vertébrés sociaux, de la chauve-souris aux primates, et des chercheurs
de plus en plus nombreux utilisent les modèles de la sociobiologie animale
pour tenter de découvrir des choses sur le comportement humain.
- C'est peut-être pour cette raison que
cette science a plutôt mauvaise réputation...
- Si les fondateurs de la sociobiologie avaient déclaré qu'elle
était limitée aux animaux, il n'y aurait jamais eu de polémique.
On peut dire la même chose de la théorie de l'évolution
de Darwin, longtemps combattue pour avoir affirmé que l'homme avait un
ancêtre commun avec le singe, une idée qui paraissait, au siècle
dernier, scandaleuse et impensable, mais qu'on a bien fini par accepter. Dans
le cas de la sociobiologie, tout est parti de la publication, en 1975, d'un
livre du célèbre biologiste américain Edward Wilson, intitulé
«Sociobiology». Dans son 27e et dernier chapitre, celui-ci commettait
le «sacrilège» d'extrapoler à l'homme certaines de
ses réflexions sur les bêtes. Cela a été pris comme
une remise en question du libre arbitre, et c'est ce qui a mis le feu aux poudres.
En France, on a ainsi perdu de vue l'aspect novateur des 26 autres chapitres,
beaucoup moins sujets à disputes. Wilson évoquait simplement dans
ces pages l'existence de bases biologiques au comportement social humain. Bien
des gens ont déformé ses propos, en suggérant qu'il affirmait
que notre comportement sosmementait biologiquement déterminé.
Il est vrai que, au lieu d'adopter un ton diplomatique sur ce terrain particulièrement
sensible, il s'est exprimé de façon assez provocatrice. Mais la
science ne progresse généralement pas sous la houlette des conformistes:
elle resterait sclérosée si certains ne prenaient pas le risque
de choquer l'establishment intellectuel. Wilson voulait bousculer une tradition
qui consiste à dénier tout intérêt à l'histoire
naturelle dans la compréhension de nos comportements actuels.
- Mais la sociobiologie n'affirme-t-elle pas qu'une
bonne partie de ces comportements sont justement déterminés génétiquement?
- Les gènes constituent un héritage reçu de l'évolution.
Personne ne conteste qu'ils soient nécessaires à toute expression
du vivant. Retirez les gènes d'un être humain, et vous obtiendrez
un amas de gelée flasque et muette! Cela ne suffit pas pour dire que
les comportements eux-mêmes sont inscrits dans les gènes. D'ailleurs,
je ne connais pas de sociobiologiste qui soutienne cette thèse, même
à propos des insectes. Soyons clairs: le patrimoine héréditaire
ne dicte pas nos attitudes; il prédispose, plus ou moins fortement, à
leur manifestation. L'effet des gènes se combine à l'information
apportée par les circonstances vécues, et c'est bien ce qui rend
difficile, voire parfois impossible, la distinction entre ce qui relève
de l'acquis et de l'inné. On peut dire qu'un comportement est comparable
à la pâte d'un kouglof, dans laquelle se mélangent des éléments
divers comme la farine, les oeufs ou le beurre: une fois le gâteau cuit,
il devient impossible de distinguer les ingrédients de départ.
- Mais, dans le kouglof, il y a des raisins secs,
qui restent identiques au départ et à l'arrivée...
- Oui, il existe, même chez l'homme, certains comportements dont la prédisposition
héréditaire est si puissante qu'ils semblent ne pas être
influencés par l'environnement ou les circonstances. C'est le cas du
réflexe de succion, déjà en place chez le foetus, ou de
la peur des serpents, très forte chez la plupart d'entre nous. Mais les
gènes transmettent aussi aux animaux et aux hommes des capacités
d'apprentissage, des prédispositions issues de l'évolution qui
leur permettent justement de s'affranchir du déterminisme biologique.
- Pourquoi, alors, cette science a-t-elle été
marginalisée?
- C'est sans doute l'une des questions les plus intrigantes de l'histoire des
idées en France. On est surpris de la force avec laquelle ce tabou s'est
imposé. J'ai entendu, il y a peu d'années, un haut responsable
du CNRS déclarer devant un large auditoire qu'il était dans les
missions de cet organisme de lutter contre la sociobiologie! Un tel déficit
d'information chez un responsable alors en charge de l'avenir scientifique français
avait de quoi stupéfier. Cette situation est particulière à
notre pays. Elle tient au fait que le débat y a été accaparé
par des gens qui n'étaient pas des scientifiques spécialistes
du domaine et qui poursuivaient des objectifs idéologiques. Tout d'abord,
à la fin des années 70, ce sont des intellectuels issus de ce
l'on appelait à l'époque la nouvelle droite qui ont fait connaître
la sociobiologie au public français. Mais en faisant une lecture grossièrement
erronée. Ces théoriciens de la droite radicale avaient trouvé
dans cette discipline un moyen de justifier des inégalités sociales,
sexuelles ou raciales par des différences biologiques. Or, si les biologistes
sont les premiers à observer les différences naturelles, ils ne
les considèrent pas pour autant comme des inégalités: au
contraire, elles constituent une richesse, tant à l'intérieur
d'une espèce qu'entre des espèces différentes. Cet amalgame
entre la science et l'idéologie a constitué une première
manipulation.
- Vous voulez dire qu'il y en a eu d'autres?
- Ce discours a vite provoqué une levée de boucliers de la part
d'autres intellectuels qui, là encore, n'étaient pas des spécialistes
du domaine. Les «opposants» provenaient de sensibilités diverses
- des gens d'extrême gauche côtoyant des catholiques conservateurs
et antidarwiniens. Ces derniers ont porté la contradiction sur le terrain
idéologique. Mais au lieu de dénoncer l'amalgame fait par la nouvelle
droite, ils l'ont, au contraire, avalisé, en diabolisant la sociobiologie,
dont le nom même s'est retrouvé associé à ses thuriféraires.
Résultat: par ignorance, le développement de ces recherches s'est
trouvé totalement bloqué en France.
- Vous dites que la polémique n'a pas été
lancée par des spécialistes. Mais comment ces derniers ont-ils
réagi?
- Les biologistes compétents dans le domaine, ceux qui travaillaient
sur les sociétés animales, sont restés muets. Ils ont refusé
d'entrer dans le débat, ce qui a encore contribué à cautionner
la double falsification des partisans et des adversaires de la sociobiologie.
Pourquoi ce silence? J'avoue qu'à l'époque cela m'a beaucoup intrigué.
J'étais alors un jeune chercheur et j'avais été impressionné
par les travaux antérieurs de Wilson, qui m'inspirait, comme à
beaucoup d'autres, de l'admiration. Je ne parvenais pas à admettre qu'un
scientifique ayant une vision si pertinente de son domaine puisse être
l'affreux personnage que l'on décrivait. Aujourd'hui, je pense avoir
trouvé l'explication: généralement hostiles au darwinisme,
les spécialistes étaient tout simplement ravis de voir mettre
à mal la sociobiologie sur la place publique, parce qu'à travers
elle c'était toute la théorie de l'évolution qui se trouvait
remise en question. Effectivement, leur silence a largement aidé à
freiner la pénétration des idées évolutionnistes
en France. Une triste situation dans laquelle ils portent une lourde part de
responsabilité.
- Et à l'étranger, comment la sociobiologie
a-t-elle été accueillie?
- En Grande-Bretagne, le débat est resté limité aux milieux
scientifiques, surtout à Oxford et à Cambridge. En Allemagne,
c'est une question qui a surtout intéressé les philosophes. Au
Japon, ce sont les milieux conservateurs - par exemple, à l'université
de Kyoto - qui se sont opposés à la sociobiologie, alors que les
progressistes des universités de gauche, par exemple à Nagoya,
étaient séduits par les nouvelles théories. Il n'y a qu'aux
Etats-Unis où la polémique ait fait rage, avant chez nous, d'ailleurs.
- Les Américains ont donc, eux aussi, rejeté
la sociobiologie?
- La différence fondamentale entre la France et les Etats-Unis, c'est
que, là-bas, l'affrontement s'est prolongé sur le plan scientifique.
Wilson a d'abord été contesté de façon véhémente
par ses pairs, en particulier par deux de ses collègues de Harvard, le
généticien Richard Lewontin et le paléontologue Stephen
Jay Gould, lesquels animaient un groupe marxiste nommé Science for the
people. Wilson s'est battu comme un lion, il a même suivi des cours du
soir de philo pour comprendre ce qui se passait. Mais les Américains
ne se sont pas contentés de l'affrontement idéologique. En marge
de la polémique, les chercheurs se sont mis à travailler sur les
concepts sociobiologiques, afin de tester leur pertinence. Les résultats
sont tombés. Sur bien des points, ils confirmaient l'intérêt
de la démarche. Résultat: cette discipline est aujourd'hui enseignée
dans toutes les grandes universités américaines, où elle
a été largement réhabilitée. Tandis qu'en France
la polémique se refermait sur un tabou.
- Revenons aux questions soulevées par
cette science. Pourquoi devient-on social? Certaines espèces s'organisent
en société alors que d'autres préfèrent vivre en
solitaire. Y a-t-il une explication biologique à cette différence?
- Première constatation, la vie en société est apparue
relativement tardivement dans l'évolution, alors que le mode de vie solitaire
est le plus ancien. La collectivité semble plus rentable du point de
vue de la survie, car elle permet d'accumuler le travail de chaque individu.
Ainsi, une guêpe solitaire doit chercher une proie, mettons une araignée,
se battre avec elle, la paralyser, la ramener au terrier, pondre dessus et refermer
le terrier. Si, à un moment quelconque de cet enchaînement, la
guêpe périt, tout le travail réalisé jusque-là
est perdu. Chez la guêpe sociale, si l'individu disparaît, un autre
reprendra le travail qu'il a commencé pour l'achever à sa place:
il y a toujours un gain proportionnel à l'investissement réalisé.
Alors que, dans la forme de vie solitaire, l'alternative est tout gagner ou
tout perdre.
- C'est donc une notion d'efficacité qui
prévaut?
- Le succès évident des espèces sociales tend à
le prouver. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les espèces solitaires
soient condamnées à disparaître. Dans un même groupe
zoologique, il peut y avoir des «anciens» et des «modernes».
Il est intéressant de pouvoir les comparer et d'en rechercher les avantages
respectifs.
- Mais par quels mécanismes biologiques
les individus sont-ils poussés à s'organiser en société?
- Cette question a longtemps turlupiné Darwin, qui s'était beaucoup
intéressé aux sociétés d'insectes et se demandait
pourquoi presque tous les individus y sont stériles. Dans une ruche,
il n'y a qu'une reine pour des milliers d'ouvrières. Sur 1 000 oeufs
pondus, 999 proviennent de la reine. Et presque tous se développent en
ouvrières incapables de procréer. Comment donc la stérilité
peut-elle être transmise de génération en génération
avec un tel succès? Darwin s'en est tiré par la notion de «sélection
familiale»: selon lui, les individus stériles devaient favoriser
la reproduction de leurs apparentés fertiles. Il a fallu attendre un
siècle - 1964 - pour qu'une explication compatible avec la génétique
soit imaginée par un étudiant en biologie de l'université
de Londres, William Hamilton. Un mécanisme auquel on a donné le
nom de «sélection de parentèle» et qui constitue l'un
des outils les plus efficaces de la sociobiologie.
- De quoi s'agit-il?
- La théorie de la parentèle permet de prédire que des
comportements sociaux dits «altruistes» auront d'autant plus tendance
à apparaître au cours de l'évolution que les partenaires
sont proches génétiquement. Cela suppose que les individus soient
capables de distinguer les membres de leur famille des non-apparentés.
Cette théorie a été largement confirmée chez la
plupart des insectes sociaux, comme les fourmis, les abeilles et les guêpes,
ainsi que chez certains vertébrés, par exemple les crapauds, les
rats, les souris et les chauves-souris. Presque tous les animaux sociaux ont
pour origine une structure familiale, donc un ensemble de partenaires apparentés.
- Pour pouvoir exprimer des tendances «altruistes»,
les animaux doivent donc être capables d'identifier leurs proches, autrement
dit d'évaluer leur degré de proximité génétique.
Mais comment?
- La reconnaissance des apparentés passe par des fonctions, comme l'odorat,
qui permettent de percevoir des marqueurs biologiques portés à
la surface du corps. Ces marqueurs sont de plusieurs types, mais il s'agit généralement
de substances odoriférantes. Chacun d'entre nous émet ainsi un
cocktail de molécules qui lui est propre et qui dépend à
la fois du patrimoine génétique et du régime alimentaire.
Ainsi, des chiens à l'odorat très développé comme
les bergers d'Alsace peuvent parfaitement distinguer deux faux jumeaux (génétiquement
différents) alimentés de la même façon. En revanche,
ils sont incapables de faire la différence entre deux vrais jumeaux (même
patrimoine génétique) nourris identiquement. Les travaux très
rigoureux d'une équipe américaine ont démontré que,
chez l'homme, cette reconnaissance olfactive pouvait s'effectuer entre parents
et enfants mais également entre tantes et nièces, grand-mères
et petits-enfants.
- Mais comment ces odeurs sont-elles associées
au patrimoine génétique?
- Il s'agit d'un mécanisme lié aux «groupes tissulaires»,
découverts par le Pr Jean Dausset, qui jouent un rôle essentiel
dans le système immunitaire. Chacun de nous appartient à l'un
de ces groupes, qui sont caractérisés par des molécules
de marquage à la surface de nos cellules. Une sorte d'empreinte que les
globules blancs reconnaissent, ce qui leur permet de ne pas s'attaquer à
l'organisme lui-même, mais aux intrus, comme les bactéries et les
virus, qu'ils sont chargés d'éliminer. Ces molécules d'identification
sont codées par des gènes réunis dans ce qu'on appelle
le «système HLA». Pour éviter le rejet d'un organe
greffé, le HLA du donneur et celui du receveur doivent être le
plus proche possible. L'idéal est une greffe pratiquée entre deux
vrais jumeaux. Eh bien, il a été montré qu'une corrélation
existait entre les marqueurs olfactifs et le HLA, ou son équivalent,
chez les mammifères. L'évolution a probablement bricolé
ainsi un procédé de reconnaissance sociale à partir du
système de reconnaissance immunitaire, qui lui était bien antérieur.
- Cela veut-il dire que les comportements altruistes
ne peuvent apparaître qu'entre parents?
- Non, l'altruisme peut également exister entre des individus non apparentés...
à condition qu'il soit payé de retour. C'est ce que nous appelons
l' «altruisme réciproque». En effet, si un animal vient en
aide à des non-apparentés profiteurs, qui ne le lui rendent jamais,
il aura peu de chances de survivre dans la compétition naturelle. Et
les gènes qui le prédisposaient à cet altruisme disparaîtraient,
faute de pouvoir se transmettre. Mais si l'altruisme est réciproque,
la formule se révèle excellente. Prenons l'exemple d'un individu
passant à proximité d'un congénère attaqué
par un ennemi qui ne lui laisse qu'une chance sur deux de s'en tirer. S'il lui
vient en aide, ils auront à eux deux, mettons, 19 chances sur 20 de vaincre
l'assaillant. Si, plus tard, la situation est renversée, de sorte que
l'assailli d'hier devienne l'altruiste d'aujourd'hui, et que tous deux viennent
à bout d'un nouvel ennemi, dans le bilan global, chacun des deux aura
échangé un risque sur deux de périr contre une chance sur
vingt. L'altruisme réciproque a été mis en évidence
chez des macaques et chez des vampires d'Amérique centrale, où
il fonctionne toujours entre les mêmes partenaires non apparentés...
- Est-on certain que ce type de comportement soit
d'origine biologique, et non pas le résultat d'un apprentissage?
- L'acquis culturel est indéniable dans le cas de l'espèce humaine,
où l'altruisme réciproque apparaît comme une évidence.
Le raisonnement de l'homme se substitue peut-être à un mécanisme
biologique existant chez l'animal, mais le résultat est le même.
- Vous évoquez, dans votre livre, la possibilité
de voir émerger des formes de vie plus complexes que la société.
Lesquelles?
- On peut s'attendre que l'étape suivante de l'évolution sera
la société de sociétés, ce que j'appelle le «coopéron
supra-social». Il est déjà réalisé chez 4
ou 5 espèces de fourmis! Je pense que, chez les vertébrés,
l'espèce humaine - avec ses tribus, ses villes et ses nations - reste
la seule à avoir atteint cette forme d'organisation.
- Pensez-vous, comme Wilson, qu'il soit possible
de tirer une morale de ces découvertes?
- Je serai clair: même si elle a contribué au progrès des
connaissances, aucune science, biologique, sociale ou autre, ne peut s'arroger
le domaine de la morale. Même si ses serviteurs sont animés des
meilleures intentions du monde. La morale, c'est l'affaire de la communauté
sociale dans son ensemble. C'est sans doute le seul point fondamental sur lequel,
comme la plupart des sociobiologistes, je suis en désaccord avec Wilson.
L'histoire récente nous apprend que le stalinisme et le nazisme ont été
deux perversions d'une même erreur: celle de considérer que la
nature était conforme aux présupposés idéologiques.
On connaît la suite...