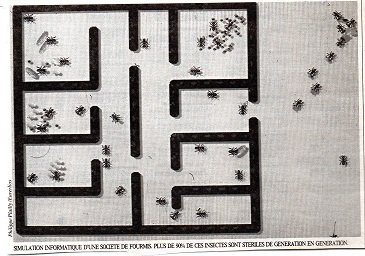
Faut-il brûler la sociobiologie ? L'altruisme ou la mort.
Alain Lenoir Mis à jour 13-Mai-2021
Interview de Pierre Jaisson par Catherine Mallaval, Libération. 26 janvier 1994.
QUESTION A PIERRE JAISSON
PR D'ETHOLOGIE A L'UNIVERSITE DE VILLETANEUSE, FONDATEUR DU LABORATOIRE D'ETHOLOGIE
EXPERIMENTALE, CNRS(1)
Qu'elle plaise ou non, la sociobiologie existe. Cette discipline, qui s'intéresse
aux fondements biologiques des comportements sociaux, fait sans conteste partie
de celles qui ont le plus fait avancer la connaissance ces vingt dernières
années. Cela, les Français ne le savent pas, tant cette science
a fait ici l'objet d'à-priori, de malentendus et, finalement, d'un véritable
tabou. La polémique, pourtant, n'est pas partie de Paris, mais des Etats-Unis,
précisément de l'université de Harvard. C'était
en 1975, lorsqu'un spécialiste des fourmis, le Pr Edward O. Wilson, publie
l'ouvrage fondateur de cette science : "Sociobiology, The New Synthesis".
Ce pavé de 700 pages comporte 27 chapitres. Seul le dernier est consacré
à l'homme (30 pages). Aujourd'hui, tous les spécialistes sont
d'accord pour dire que sans ce chapitre, la polémique n'aurait jamais
éclaté. C'est sur l'homme, en effet, que s'est focalisée
la contestation, comme lorsque Darwin a publié l'Origine des espèces,
où il faisait entrer l'humanité dans le règne animal. Les
principaux détracteurs de Wilson sont alors deux autres membres de Harvard,
deux marxistes purs et durs: le paléontologue Stephen Jay Gould et le
généticien Richard Lewontin. Le contexte a beaucoup joué.
Au milieu des années 70, les intellectuels américains sortent
tout juste d'un grand débat sur le quotient intellectuel, débat
lancé par des extrémistes de droite. C'est pourquoi, lorsque Wilson
lance l'idée de bases biologiques aux comportements sociaux de l'animal
et de l'homme, ils montent aussitôt au créneau: ils redoutent un
remake de l'offensive lancée par les « innéistes »
réactionnaires sur la prédétermination du QI par les gènes...
Il faut dire que Wilson est allé très loin, jusqu'à prédire
rien moins que la disparition de la sociologie classique!
L'affaire s'envenime. Et, en Grande-Bretagne, la très sérieuse
revue Animai Behaviour, la référence en éthologie, tente
d'ôter à la polémique tout caractère idéologique
et de replacer le débat sur un plan strictement scientifique. Elle décide,
pour la première fois de son histoire, de soumettre le livre de Wilson
à quatorze spécialistes de re-nom mondial. Cinq donnent un avis
totalement positif sur les travaux du chercheur, six émettent quelques
réserves sur des points particuliers. Seuls trois, tous Américains,
sont négatifs. L'état de l'opinion scientifique internationale,
à la sortie du livre, est donc globalement favorable: elle ne suit pas
le procès d'intention fait à Wilson. En France, hélas,
la critique n'aura jamais rien de scientifique. La parution de l'ouvrage a la
malchance de coïncider avec la naissance de la nouvelle droite, qui regroupe
une fraction de la droite dure et des athées d'extrême droite.
Très vite, ce mouvement s'empare du sujet, croyant voir dans la sociobiologie
un fondement scientifique à leur conception de la société,
fondée sur des inégalités naturelles. En fait, ils pratiquent
l'amalgame entre deux notions qui n'ont rien à voir - la différence
et l'inégalité. Pour le biologiste, la différence est une
richesse pour l'espèce, le terreau de l'évolution. Pour la nou-velle
droite, elle devientsynonyme d'inégalité(s) et justifie le statu
quo social... Lorsque l'extrême gauche perçoit la manoeuvre, au
lieu de la dénoncer, elle décide de diaboliser la sociobiologie.
Pris entre deux feux, les scientifiques ne pipent pas mot. Pas même les
nombreux spécialistes français des insectes sociaux, directement
concernés. Voilà comment, chez nous, on a condamné la sociobiologie
sans instruire son procès. Bien entendu, la polémique française
n'a eu aucune répercussion internationale, et elle n'a pas empêché
le progrès scientifique. Mais le tabou qui s'est installé continue
de pénaliser notre biolo-gie. Il explique en partie la domination actuelle
de la biologie moléculaire, au détriment de la biologie des organismes
et des populations. Il est surtout responsable de lacunes chez nos étudiants
en biologie. Ils ne savent pas situer le phénomène social dans
l'évolution. C'en est pourtant un événement crucial, une
complexification tardive de la vie en solitaire: Par quels mécanismes
biologiques des êtres vivants ont-ils été poussés
à s'organiser en société et à le rester, c'est ce
qui intéresse le sociobologiste. Au siècle dernier, cette question
avait déjà éveillé la curiosité de Darwin.
Ce dernier ne comprenait pas comment des insectes sociaux, tels les fourmis
et les abeilles, n'avaient pas été rayés de l'évolution.
Plus de 90% de ces insectes sont en effet stériles. Par exemple, dans
une ruche il n'y a qu'une reine pour des milliers d'ouvrières. Sur 1
000 oeufs pondus, 999 proviennent de la reine. Et cette stérilité
se transmet de génération en génération avec succès:
Ajoutons à cela que les insectes sociaux connaissent un véritable
triomphe écologique.
Dans la seule forêt amazonienne, les fourmis, les termites plus les abeilles
et les guêpes sociales représentent plus de 75% de la population
d'insectes! A l'époque, Darwin ne le savait pas. Il a fallu attendre
1964, et le biologiste anglais William Hamilton (2) pour qu'une explication
compatible avec la génétique soit élaborée: la théorie
de la parentèle, l'un des outils les plus performants de la sociobiologie.
Hamilton postule que des individus stériles peuvent très bien
avoir intérêt à ne pas se reproduire pour leur propre compte,
mais à propager leurs gènes à travers des apparentés
fertiles. Il appelle cela un acte d'« altruisme » (sans référence
à une intentionalité). Les hyménoptères, comme les
fourmis ou les abeilles, en offrent une parfaite illustration. Chez ces insectes,
la reine est la mère de tous les autres membres de la société.
Lorsque l'ouvrière défend le nid ou la ruche, lorsqu'elle accumule
de la nourri-ture..., elle favorise indirectement la reproduction de sa mère,
donc la production de nouvelles soeurs. Et c'est à chaque fois une portion
de son patrimoine génétique qui se propage. De plus, un seul acte
sexuel entre la reine et un mâle sert des milliers de fois, car la reine
garde en - stock - dans une glande - le sperme du même mâle. Sperme
à partir duquel une foule de filles étroitement apparentées
sont fabriquées. Ainsi, de façon paradoxale, une fourmi qui ne
se reproduit pas mais se consacre à favoriser la reproduction de sa mère
propage plus sûrement son patrimoine héréditaire que si
elle se reproduisait elle-même. Tout ce raisonnement, Hamilton l'a mené
dans les années 60. Mais il a fallu attendre la décennie suivante
pour que Wilson s'en fasse l'imprésario. Enfin, les années 80
ont apporté la démonstration finale. En effet, pour être
certain que cette théorie fonctionne, encore fallait-il démontrer
que les adeptes de l'altruisme savent évaluer le degré de parenté
d'un congénère. Un autre pan de la connaissance que la sociobiologie
a ouvert. On sait désormais que les abeilles savent reconnaître
leurs soeurs à l'odeur. Et depuis 1987, il a été montré
que rats et souris peuvent repérer un frère ou une soeur sans
l'avoir jamais rencontré. La durée passée à explorer
un congénère est inversement propor-tionnelle au degré
de proximité génétique : plus l'individu est proche, moins
le rat va le renifler. Aujourd'hui, si la sociobiologie inspire de en plus de
recherches sur l'homme, je vous rassure: je ne connais actuellement aucun sociobiologiste
qui oserait prétendre à une prédétermination génétique
des comportements humains et même animaux.
• RECUEILLI PAR CATHERINE
MALLAVAL
(1) A publié la Fourmi et le sociobiologiste, Ed. 0 Jacob, 1993. Participe
à la semaine de la science de Saint-Michel sur Orge (jusqu'à samedi,
en association avec Libération et France-Culture). Organise en août
le prochain congrès mondial sur les insectes sociaux à la Sorbonne.
(2) a reçu, cette année, le prix Kyoto, qui se veut un concurrent
du prix Nobel
Hamilton postule que des individus stériles peuvent tout à fait avoir intérêt à ne pas se reproduire pour leur propre compte mais à propager leurs gènes à travers des apparentés fertiles. Ce qu'il appelle un acte d'«altruisme».
Voir le pdf
original